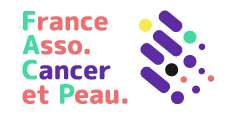Août 2021 – Les cancers kératinocytaires, c’est à dire les cancers de la peau qui ne sont pas des mélanomes, touchent dans un très grand nombre de cas des personnes de plus de 70 ans. A ces âges, la fragilité et un mauvais état de santé peuvent, d’une part, retentir sur l’évolution de ces cancers et d’autre part rendre le traitement, en général une intervention chirurgicale, plus difficile à mettre en œuvre. Une équipe de dermatologistes des Pays-Bas a recherché dans la littérature médicale les articles abordant le sujet et proposant des moyens de résoudre ces difficultés éventuelles.
L’examen de ces publications montre que la chirurgie est en fait bien supportée par les personnes âgées. La fréquence des complications et des récidives étant par ailleurs semblable à celle constatée chez les patients plus jeunes. Dans la majorité des cas, les cancers kératinocytaires (carcinomes basocellulaires et carcinomes épidermoïdes) sont des petites tumeurs que l’on peut enlever sous anesthésie locale avec un taux de guérison à 5 ans qui est de 96 %. Mais parfois les personnes âgées ont des tumeurs plus importantes en volume, ceci pouvant être dû autant à une évolution plus rapide qu’à un retard du diagnostic. Le cancer est alors beaucoup plus difficile à opérer avec la nécessité d’une excision large, malaisée à refermer, et avec le risque de ne pas « passer » suffisamment au large de la tumeur, en laissant sur place des cellules cancéreuses qui pourront entraîner la récidive du cancer. Les artifices techniques tels que la méthode de Moh’s (on enlève la tumeur par « tranches » jusqu’à rejoindre le tissu sain) qui prolongent la durée de l’intervention semblent bien supportés mais ils ne sont utilisés que chez les octo et nonagénaires en forme !
La radiothérapie peut être une bonne alternative avec de bons résultats mais elle peut aussi être difficile à assumer pour les patients âgés fragiles. Là encore des aménagements (radiothérapie hypofractionnée qui consiste à intensifier les doses à chaque séance afin de limiter le nombre de séances) sont possibles pour rendre le traitement plus tolérable, mais il faut encore vérifier que les résultats sont aussi bons que ceux de la radiothérapie conventionnelle.
Au demeurant, dans la plupart des cas, les cancers kératinocytaires sont superficiels, de petite taille et de bon pronostic. Si le patient et/ou le médecin préfèrent éviter la chirurgie, il est possible de recourir à des traitements topiques : par exemple (hors AMM) application de crèmes à base de 5 fluoro uracile ou d’imiquimod. Ce sont des traitements habituellement proposés pour les kératoses actiniques (épaississements localisés de la peau qui peuvent précéder un carcinome). Mais dans les cancers à faible risque, le taux de guérison va de 60 à 90 %. Quant à la photothérapie dynamique, également utilisée dans le traitement des kératoses actiniques, et qui consiste à l’irradiation par laser ou exposition aux UV après application d’une crème photosensibilisante, son efficacité chez la personne âgée pour la prise en charge des KA mais aussi des cancers kératinocytaires est moins certaine que pour des sujets plus jeunes. Enfin la cryothérapie (destruction par le froid) ou l’électocuretage (destruction au bistouri électrique) sont d’autres alternatives possibles.
En cas de cancers avancés avec des métastases, les possibilités thérapeutiques sont peu nombreuses : des traitements « immunologiques » existent : cémiplimab pour le carcinome épidermoïde ou vismodégib pour le carcinome basocellulaire. Même si l’âge avancé n’est pas une contre-indication à leur emploi, ils sont rarement proposés à ces patients.
Finalement dans certains cas, les patients âgés et fragiles, souffrant d’autres maladies (comorbidités), peuvent décider avec leur médecin de simplement surveiller la tumeur surtout si celle-ci n’est pas très importante, l’évolution en étant souvent très lente.
Dr Marie-Line Barbet
Leus AJG et coll. : Treatment of keratinocyte carcinoma in elderly patients – a review of the current literature. JEADV 2020, 34, 1932–1943