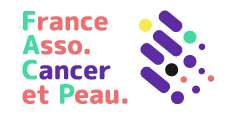Février 2020 – Le mélanome malin est le plus dangereux des cancers de la peau mais ce n’est heureusement pas le plus fréquent.
Les plus fréquents sont les cancers dit « non mélanomes » ou plus exactement les carcinomes kératinocytaires, ainsi dénommés parce qu’ils se développent à partir des cellules de l’épiderme (la couche la plus superficielle de la peau), appelées kératinocytes. Comme pour le mélanome, ils sont liés à l’exposition solaire et leur fréquence a beaucoup augmenté au cours des dernières décennies.
Deux formes sont distinguées : les carcinomes basocellulaires cutanés (CBC) et les carcinomes épidermoïdes cutanés (CEC), les premiers étant nettement plus fréquents (80 % contre 20 %) et généralement moins graves.
Bien qu’il émane d’une équipe de médecins du Royaume-Uni où les conditions d’exercice sont un peu différentes de celles de la France, un article paru dans la presse médicale apporte des notions très intéressantes, et dont il est tout à fait licite de s’inspirer, sur le diagnostic des lésions de la peau vues en « soins primaires » (c’est à dire en d’autres termes au cours d’une consultation chez le généraliste).
Les carcinomes baso cellulaires sont d’aspects très variés
Commençons par les plus fréquents des cancers de la peau : les carcinomes baso cellulaires.
Ils sont difficiles à reconnaître parce qu’ils sont très variables dans leur présentation et suivant leur localisation. Sur le visage, l’aspect est souvent celui d’un « bouton » isolé ou d’un groupe de quelques boutons disposés en cercle bien ronds et lisses comme des perles rosées plus ou moins translucides avec la présence de vaisseaux dilatés à leur surface (les télangiectasies) et parfois une plaie comme s’ il y avait eu écorchure : on parle de carcinomes baso cellulaires nodulaires.
Mais sur le tronc et les épaules il peut s’agir de plaques rouges bien limitées avec des squames (peau qui pèle) et une bordure plus marquée. Une autre forme importante est le carcinome baso cellulaire sclérodermiforme semblable à une cicatrice cireuse, et qui tend à « infiltrer » davantage l’épaisseur de la peau.
Une plaie qui n’a pas tendance à guérir
Les carcinomes épidermoïdes sont plus « monomorphes ».
Ils touchent essentiellement les zones exposées au soleil : le visage, le cuir chevelu (quand il est dégarni !), les oreilles, le cou, les membres supérieurs. Le plus souvent, c’est une lésion un peu dure, croûteuse ou une plaie sans croûte mais qui n’a aucune tendance à guérir.
Le médecin généraliste a un grand rôle à jouer pour dépister au cours de son examen, toutes ces lésions qui paraissent bénignes et sont d’ailleurs difficiles à distinguer d’autres, sans danger, liées au vieillissement de la peau (telles que les kératoses séborrhéiques par exemple ou les taches rubis) et aux antécédents d’exposition solaire. Le patient lui-même doit signaler à son médecin cette plaie, ce bouton, cette croûte qui sont apparues « un beau jour » et ne veulent pas guérir.
Le praticien pourra décider alors de confier son patient au dermatologiste qui, s’il le croit nécessaire fera une biopsie, c’est-à-dire enlèvera une partie ou toute la lésion pour qu’elle puisse être envoyée au laboratoire d’anatomopathologie. Il y sera procédé à un examen au microscope qui seul permettra de déterminer précisément s’il s’agit bien ou non d’un carcinome kératinocytaire.
Dr Marie-Line Barbet
Jones OT et coll. : Recognising Skin Cancer in Primary Care. Adv Ther., 2019 ; publication en ligne le 16 novembre.