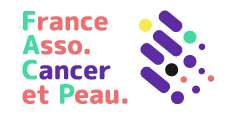Mars 2018 – La fréquence du mélanome continue d’augmenter dans les pays dont les habitants ont des ancêtres européens et ce sera probablement encore le cas pour les deux prochaines décennies.
A côté de ces constatations décourageantes, il faut tout de même souligner qu’une proportion croissante de ces nouveaux mélanomes sont diagnostiqués à un stade très précoce alors qu’ils n’ont pas dépassé l’épiderme (mélanome in situ) ou n’ont envahi le derme que sur une très faible épaisseur (moins de 1 mm). Ce sont donc des tumeurs localisées (de stade 0, I ou II), de bon pronostic, une fois enlevées chirurgicalement. Après cette intervention, il est recommandé que les patients consultent leur médecin (dermatologue ou médecin traitant) régulièrement pour que celui-ci soit à même de détecter une récidive ou un nouveau mélanome. Le rythme recommandé actuellement en France et dans la plupart des pays est de tous les six mois pendant 5 ans pour un mélanome de stade 0 à I (tous les trois mois pour un stade 2) puis une fois par an à vie.
Cependant à l’heure où l’on s’efforce partout de réduire les dépenses de santé, la question s’est posée du rapport coût/bénéfice d’une telle stratégie. Elle s’est posée de manière d’autant plus insistante que l’on constate que deux tiers de toutes les récidives et presque la moitié des nouveaux mélanomes sont détectés par les patients eux-mêmes ou leur partenaire dans l’intervalle des visites de suivi. De plus une étude ayant comparé chez des patients avec un mélanome de stade 2 une surveillance classique (tous les trois mois) à une surveillance allégée (1 à 3 visites la première année) montre qu’il n’y a eu aucune différence dans le taux de récidive et nouvelles tumeurs détectées, non plus que pour le confort mental des malades, tandis que l’économie pour le service hospitalier au bout de la première année était de 45 % avec des consultations de suivi moins fréquentes. L’économie est non seulement financière mais aussi de temps pour les médecins et pour les patients. Et, si les rendez-vous réguliers apparaissent rassurants pour les uns, ils sont source de stress pour les autres. Alors que faire dans ce contexte ? Y-a-t-il lieu de changer les recommandations ou de les assouplir ?
Pour tenter de répondre partiellement à ces questions, une étude a été entreprise en Australie (pays emblématique en matière de prise en charge des cancers de la peau) auprès de 400 des 900 patients chez lesquels avait été porté le diagnostic de mélanome localisé au MIA (Melanoma Institute Australia) entre janvier et décembre 2014. Ils ont été invités répondre à un questionnaire abordant plusieurs points : préférences concernant le suivi (classique ou « allégé »), expérience et modalités concernant cette surveillance au cours des 12 mois précédents, mode de détection des éventuels récidives ou nouveaux mélanomes. Finalement 262 patients ont accepté de se soumettre à cet interrogatoire. Ils étaient âgés en moyenne de 64,3 ans et 93 sont des femmes. Deux cent trente n’avaient pas eu de récidive ou de nouvelle tumeur au moment de l’interview. Environ 30 pour cent d’entre eux ont déclaré qu’ils auraient préféré un rythme moins soutenu de consultations de suivi pourvu que leur soit prodigué un entrainement à l’auto examen et que leur soit facilité l’accès (en moins de deux semaines) à un spécialiste en cas de découverte d’une lésion suspecte. Curieusement les patients atteints d’un mélanome in situ ou de stade I étaient moins favorables à un suivi « relâché » que ceux avec un stade 2. Les personnes souffrant d’autres maladies (et donc voyant d’autres médecins) n’ayant pas de mutuelle, non célibataires et dont le mélanome était situé sur la jambe se déclaraient également plus souvent favorables à une surveillance moins étroite. Plus généralement, la majorité préfère un rythme de suivi tel que dicté par les recommandations parce qu’ils plébiscitent les consultations face à face et n’ont pas confiance dans l’auto-examen
Pour autant, seuls 13 participants ont signalé avoir manqué un ou des rendez-vous dans leur suivi tandis que 8 autres ne s’étaient soumis à aucune surveillance.
Sept patients (parmi les 262 volontaires pour cette étude) ont signalé avoir eu une récidive et trois un nouveau mélanome. Dans environ la moitié des cas l’entourage, le patient lui-même ou un autre médecin avait détecté cette récidive ou cette nouvelle tumeur entre deux consultations de suivi programmé.
Cependant environ 40 % des personnes interrogées ne faisaient pas d’auto-examen ou en faisaient à plus de trois mois d’intervalle et moins de la moitié demandait de l’aide à l’entourage pour l’examen.
Au total, cette étude montre que la plupart des patients se plient « volontiers » au rythme de suivi qui leur est recommandé. Il pourrait cependant être possible que, dans certains cas, le praticien puisse opter pour un nombre de consultations moindre en toute sécurité pour certains patients capables de bien mener un auto-examen, auquel ils peuvent être formés grâce à des supports en ligne, vidéos et applications. Le développement de la télédermatologie pourrait également être un moyen de réduire le rythme des consultations si l’on veut tenter d’épargner finalement le temps et l’argent des uns et des autres en toute sécurité et en préservant le bien-être psychique des patients.
Dr Marie-Line Barbet
Wei-YinLim et coll. : Patient Preferences for Follow-up After Recent Excision of a Localized Melanoma. JAMA Dermatol., 2018 ; publication avancée en ligne 28 février. doi: 10.1001/jamadermatol.2018.0021.