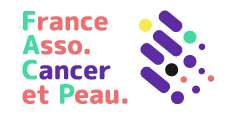En 2009, un groupe d’experts nommés par l’International Agency for Research on Cancer a déclaré que les UV naturels et artificiels pouvaient favoriser l’apparition de cancers cutanés chez l’Homme et les a donc classés parmi les éléments et substances « carcinogènes ». Ceci était l’aboutissement de 50 années d’observations et de recherches, recherches qui avaient été particulièrement stimulées par la constatation de la croissance régulière du nombre des cancers cutanés et en particulier des mélanomes depuis la fin de la deuxième guerre mondiale.

Jusqu’au début des années quatre-vingts pourtant, le rôle des ultraviolets (UV) dans le développement des mélanomes ne faisait pas consensus à l’inverse de ce qu’il en était pour les carcinomes épidermoïdes cutanés clairement attribués à une exposition « chronique » au soleil. Au fil des ans on a pu cependant constater que l’implication des UV dans la survenue des mélanomes se faisait selon deux modèles : d’une part lors des expositions intermittentes « récréationnelles » dans un but esthétique et/ou lors des loisirs ou de vacances et d’autre part en tant que conséquence de l’accumulation des UV reçus tout au long de la vie. Dans le premier cas cela expliquait l’accroissement du nombre de cas de mélanomes parallèlement à l’augmentation du tourisme de masse avec des populations à peau claire d’origine nordique venant prendre des bains de soleil sous d’autres latitudes : ces mélanomes touchent des patients plus jeunes et se situent sur des zones du corps habituellement cachées par les vêtements. Dans le deuxième cas les mélanomes sont situés sur les zones habituellement découvertes et atteignent des personnes plus âgées qui ont été exposées toute leur vie aux UV du fait de leur lieu de résidence et/ou de leurs occupations professionnelles.
En résumé, qu’elle soit chronique ou intermittente, l’exposition aux UV naturels ou artificiels est donc un facteur de risque de mélanome malin.
Mais une autre constatation importante vient de l’observation des personnes qui ont émigré d’une région à faible ensoleillement vers une région à fort ensoleillement (et vice versa) alors qu’elles étaient enfants. Elle fait apparaître que l’exposition aux UV pendant l’enfance est en quelque sorte un « pré requis » à la survenue d’un mélanome à l’âge adulte. Ainsi la probabilité d’avoir un mélanome pour des personnes qui sont nées et ont été élevées en Australie, en Californie, en Israël ou autre pays de soleil reste plus élevée que la probabilité d’avoir un mélanome pour les personnes nées plus au Nord et venues dans ces pays entre 10 et 20 ans. Le jeune âge au moment de l’immigration dans un pays ensoleillé a plus d’importance vis-à-vis du risque de mélanome que la durée de résidence dans ce pays. Tout ceci souligne l’influence majeure de l’exposition aux UV pendant l’enfance sur le développement ultérieur d’un mélanome.
Le nombre élevé de grains de beauté ou naevus mélanocytaires constitue un autre marqueur de risque de mélanome. Or il semble là encore que l’apparition de ces naevus, leur nombre, leur taille (plus de 5 mm), leur forme soient influencés par l’exposition au soleil, intermittente ou chronique dans l’enfance, les coups de soleil à cet âge jouant un rôle particulièrement délétère.
Les expériences sur les animaux ont également montré que l’exposition aux UV « doit » intervenir tôt dans la vie pour provoquer les anomalies biologiques susceptibles d’entraîner l’apparition d’un mélanome à l’âge adulte (les mélanomes avant l’âge de 20 ans étant exceptionnels).
Les mécanismes par lesquels les UV agissent ne sont pas parfaitement élucidés. Mais l’on sait depuis une quinzaine d’années que les UVA sont aussi dommageables que les UVB, ce qui a largement remis en question la sécurité des cabines de bronzage (utilisant des UVA), désormais considérées comme nocives et dont la fréquentation ne devrait pas être autorisée avant 18 ans.
Ainsi les travaux scientifiques des dernières décennies ont-ils permis d’identifier clairement l’ennemi numéro 1 dans la lutte contre le mélanome. Ce sont les UV, particulièrement ceux reçus dans l’enfance. C’est redire l’importance d’une protection rapprochée à cet âge : vêtements, crèmes photo protectrices à indice élevé, évitement des expositions aux heures les plus ensoleillées, recherche de l’ombre. Ce n’est qu’à ce prix que le nombre de mélanomes pourra diminuer.
Dr Marie-Line Barbet
Autier PH, Doré JF : Ultraviolet radiation and cutaneous melanoma: a historical perspective.
Melanoma Res.,. 2020; 30(2):113-125. doi: 10.1097/CMR.0000000000000609.