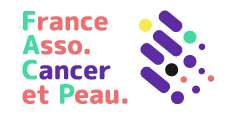Janvier 2018 – Les tatouages sont très à la mode actuellement et l’on estime qu’un quart de la population entre 18 et 59 ans arbore ces décorations aux USA. Le phénomène est un peu moins répandu en Europe mais concernerait tout de même 10 à 15 % des personnes dans la même tranche d’âge et 25 % des moins de 30 ans, en France par exemple. Au-delà de sa signification socioculturelle qui reste débattue, cette tendance n’est malheureusement pas sans risque pour la santé. En effet les composants chimiques des encres utilisées pour réaliser les tatouages ont tous une toxicité potentielle propre parfois encore mal connue. On sait qu’ils peuvent provoquer des allergies et des inflammations chroniques. Mais présentent-ils un danger en terme d’apparition de cancer de la peau ?
L’examen de la littérature médicale parue sur le sujet retrouve une cinquantaine de publications dans lesquelles il est fait mention de 63 cas de cancers de la peau associés à des tatouages. Parmi ceux-ci il y avait 21 mélanomes, les autres cancers étant des carcinomes (12 épidermoïdes et 11 basocellulaires) ou d’autres cancers plus rares. Les deux tiers de ces tumeurs étaient localisées aux membres et extrémités, c’est-à-dire dans les zones les plus exposées au soleil au cours de la vie. Dans 58 % des cas, elles étaient associées à l’emploi d’une encre bleue et noire, et dans 34 % des cas à une encre rouge. Le délai d’apparition du cancer était très variable, parfois très court, avec par exemple un mélanome décelé 3 mois après le tatouage.
Même si il est difficile d’affirmer un lien entre le tatouage et le cancer, il faut souligner que le tatouage implique l’injection dans la peau d’une quantité variable de pigments qui vont être détectés comme des substances étrangères et provoquer différentes réactions du système immunitaire (système de défense de l’organisme) et qui peuvent aussi être à l’origine d’anomalies dans les couches profondes de la peau. De plus la composition précise des encres des tatouages n’est pas standardisée ni à l’échelon national ni à l’échelon international. Or on retrouve dans les encres noires, en particulier, des substances carcinogènes telles que fer, phénols et noir de charbon. Il a été également rapporté que l’encre rouge pouvait contenir des substances potentiellement carcinogènes : mercure (désormais éliminé par la majorité des fabricants), pigments monoazoïques, cadmium, cobalt, chrome… Le dioxide de titane et l’aluminium employés pour éclaircir les tatouages, peuvent aussi avoir de tels effets.
Il faut ajouter que pour le dermatologiste, la présence du tatouage rend plus difficile l’examen des naevus (grains de beauté) présents sur la zone du dessin : il peut être ainsi malaisé de déterminer si un naevus est en train de se transformer en mélanome (ou même si c’était déjà le cas avant que ne soit effectué le tatouage). A tout le moins il faudrait ne pas choisir un endroit où la peau est déjà abimée par le soleil et/ou est le siège d’un ou plusieurs naevus, pour faire un tatouage !
Toutes ces observations inclinent à faire figurer le tatouage dans la liste des facteurs de risque de développement de cancer de la peau, d’autant que beaucoup de cas identiques n’ont probablement pas été signalés. La fréquence de ces cancers cutanés associés au tatouage est donc certainement plus élevée qu’il n’y paraît et elle risque de croître avec l’engouement actuel pour cette pratique. Il convient d’être particulièrement prudent quand d’autres facteurs de risque de mélanome sont présents. Et il faut aussi à espérer que le potentiel carcinogène des différentes encres de tatouages soit mieux précisé et que leur emploi fasse l’objet d’une réglementation.
Dr Marie-Line Barbet
Paprottka FJ et coll. : Trendy Tattoos—Maybe a Serious Health Risk? Aesthetic Plast Surg. 2018; 42: 310-321. doi: 10.1007/s00266-017-1002-0