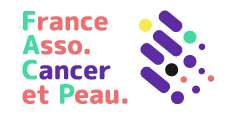Janvier 2015 – Le risque lié au bronzage artificiel n’est plus à démontrer. Cependant, rares sont les pays qui en s’appuyant sur les données scientifiques disponibles ont choisi d’aller jusqu’à interdire les cabines à UV. Qu’en est-il en France ?
Le Brésil a été le premier à franchir le pas, bientôt imité par la Nouvelle-Galles-du-Sud, un état australien. Depuis le 1er janvier, l’ensemble des autres provinces de ce pays ont suivi cet exemple et désormais le bronzage artificiel en institut (mais pas dans un cadre privé) est banni. En Australie, cette décision s’inscrit dans une lutte généralisée contre les méfaits du soleil où la sensibilisation commence dès le plus jeune âge et où les incitations à la protection connaissent de nombreuses formes, mobilisation qui s’explique par le fléau que représente les cancers de la peau dans ce pays. Plusieurs campagnes chocs se sont notamment multipliées ces dernières années. Parmi elles, le témoignage en 2007 de Clare Oliver, adepte des cabines de bronzage et victime à l’âge de 25 ans d’un mélanome a contribué à une véritable prise de conscience quant aux dangers du soleil artificiel, qui huit ans plus tard aboutissait à l’interdiction.
Qu’en est-il en France ? Ces dernières années la législation a été renforcée répondant aux exigences exprimées par les spécialistes. Ainsi, deux arrêtés ont été publiés cet automne, visant les appareils à UV et les institutions qui les exploitent. En vertu de ces textes il est entre autres désormais obligatoire de faire figurer sur les appareils une mention avertissant des dangers associés aux UV artificiels : « Il est recommandé de ne pas avoir recours aux appareils de bronzage. Le rapport bénéfice/risque pour la santé de l’utilisation de ces appareils est négatif et en défaveur des appareils de bronzage » doit ainsi désormais être inscrit sur toutes les installations et publicités. Les notices d’emploi devront par ailleurs se montrer explicites sur le risque accru de cancer de la peau, les dangers ophtalmologiques et la nécessité absolue de porter des luettes de protection. Les arrêtés préconisent également plusieurs autres recommandations d’emploi à l’intention de ceux qui ne seraient pas échaudés par les premiers avertissements : nécessité d’attendre au moins 48 heures entre deux expositions à des UV artificiels et de prendre garde à l’utilisation des médicaments photosensibilisants. Par ailleurs, la traçabilité des appareils et les conditions de leur contrôle ont été renforcées.
Ces réglementations font suite à de précédents arrêtés qui réglementaient déjà strictement la publicité, les avertissements sanitaires et interdisaient la vente de soleil en cabine aux mineurs. Ces textes sont cependant loin d’être parfaitement appliqués comme ont notamment pu le révéler plusieurs enquêtes mettant en évidence que les moins de 18 ans ne sont pas systématiquement éconduits par les marchands de soleil. Aussi, beaucoup redoutent que les nouveaux textes ne soient guère mieux respectés et s’interrogent sur leur efficacité. D’une manière générale, de nombreux spécialistes se sont déjà exprimés à plusieurs reprises en faveur d’une législation bien plus stricte, semblable à celle qui existe désormais en Australie.
En France, on estime en se basant sur une extrapolation réalisée par l’équipe de Mathieu Boniol (International Prevention Research Institute) publiée en 2012 dans le Bulletin épidémiologique hebdomadaire que 4,6 % des cas de mélanomes cutanés pourraient être attribués à l’utilisation des cabines de bronzage, provoquant entre 19 et 76 morts chaque année (sur un total d’environ 10 000 cas).