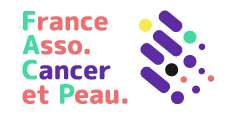Les lauréats 2014 sont Lionel Apetoh, Inserm 866 à Dijon, pour son projet intitulé « Etude des mécanismes cellulaires et moléculaires responsables des propriétés anticancéreuses des cellules T CD4 productrices d’interleukine 9 (Th9) induites en présence d’interleukine 1ß » et Marina Kvaskoff, Inserm U1018 à l’IGR de Villejuif, pour son projet d’épidémiologie visant à explorer les relations entre les facteurs pigmentaires, l’exposition solaire, les polymorphismes de certains gènes et le risque de mélanome cutané dans une étude cas témoin nichée dans la cohorte prospective française E3N.
Résumé du projet de recherche de Lionel Apetoh
« Etude des mécanismes cellulaires et moléculaires responsables des propriétés anticancéreuses des cellules T CD4 productrices d’interleukine 9 (Th9) induites en présence d’interleukine 1ß»
Mots-clés : mélanome, lymphocytes T CD4, thérapie cellulaire, Interleukine-1ß, inflammation
Mon projet de recherche a pour objectif d’établir les bases moléculaires responsables des propriétés anticancéreuses des cellules T CD4 productrices d’interleukine 9 (cellules Th9) induites en présence d’IL-1ß.
Les cellules Th9 ont été mises en évidence en 2008. Elles produisent de fortes quantités d’interleukine 9 et possèdent de fortes propriétés proinflammatoires in vivo. Bien que ces cellules aient été à l’origine identifiées en raison de leur capacité à renforcer des réponses inflammatoires dans des modèles de colite et d’asthme, des travaux récents suggèrent que ces cellules possèdent également de fortes propriétés anticancéreuses dans des modèles murins de mélanome.
Cependant, les mécanismes favorisant la génération de ces cellules restent mal connus à ce jour et la contribution potentielle d’autres cellules du système immunitaire aux effets anticancéreux des Th9 n’a pas été clairement établie. Ainsi, malgré leurs propriétés anticancéreuses, l’absence d’outils permettant de contrôler les fonctions effectrices des cellules Th9 limite leur utilisation potentielle en thérapie cellulaire du mélanome.
Nos données actuelles indiquent que les cellules Th9 présentent des propriétés anticancéreuses renforcées lorsqu’elles sont différenciées en présence d’un facteur proinflammatoire, l’interleukine 1ß, en comparaison avec des cellules Th9 différenciées de façon conventionnelle. Cette activité exceptionnelle suggère que ces cellules Th9 induites en présence d’interleukine 1ß jouent un rôle majeur dans la prévention du développement de cancers. L’interleukine 1ß ne facilite pas simplement la génération de cellules Th9 mais, de manière inattendue, induit un nouveau facteur de transcription dans les cellules Th9 en développement qui va dicter leurs fonctions effectrices et leurs propriétés anticancéreuses.
Pour renforcer le potentiel anticancéreux des cellules Th9, nous allons d’abord décrypter la série d’événements moléculaires qui confèrent des propriétés anticancéreuses aux cellules Th9 induites en présence d’interleukine 1ß puis déterminer leur devenir in vivo et leurs interactions avec d’autres cellules immunitaires effectrices. Ces objectifs seront poursuivis en analysant in vitro et in vivo l’expression génétique des cellules T CD4 différenciées en cellules Th9 en présence d’interleukine 1ß et en utilisant des souris transgéniques.
La découverte des voies de signalisation responsables de l’effet anticancéreux des cellules Th9 induites en présence d’interleukine 1ß permettrait de fournir un outil thérapeutique capable de moduler l’activité biologique des cellules Th9 afin d’envisager leur utilisation en immunothérapie du mélanome.
Résumé du projet de recherche de Marine Kvaskoff
Ce projet d’épidémiologie vise à explorer les relations entre les facteurs pigmentaires, l’exposition solaire, les polymorphismes de certains gènes et le risque de mélanome cutané dans une étude cas témoin nichée dans la cohorte prospective française E3N.
E3N (Etude Epidémiologique auprès de femmes de l’Education Nationale) est une grande étude de cohorte prospective portant sur 100 000 femmes françaises affiliées à la Mutuelle Générale de l’Education Nationale, et nées entre 1925 et 1950. Ces femmes sont suivies depuis 1990 par auto questionnaire environ tous les 2-3 ans. Un questionnaire spécifique a été envoyé aux participantes de la cohorte qui avaient déclaré un mélanome (cas) ainsi qu’à 3 femmes indemnes de cancer (témoins), afin de recueillir des données détaillées sur leur exposition aux rayonnements ultraviolets (UV) et leurs facteurs pigmentaires (couleur des yeux, réaction de la peau au soleil, etc.). Un questionnaire a été reçu pour un total de 368 cas de mélanome ainsi que pour 1104 témoins.
Outre leur nombre de coups de soleil à différents âges, l’utilisation de crème solaire et l’utilisation de solarium, les participantes ont renseigné un journal de lieux de résidence et de vacances tout au long de leur vie, que nous avons lié à une base internationale contenant les doses d’UVA, UVB, UV total et UVE (érythémale) selon la géolocalisation de différents lieux. A partir de ces données, nous avons construit une base de données UV, qui a permis d’appliquer le calcul d’un score UV sur l’ensemble de la population d’étude.
En parallèle, des analyses génétiques ont été réalisées sur la totalité des cas de mélanome pour lesquels un échantillon biologique était disponible, ainsi que chez 2 témoins par cas (total de 700 cas de mélanome et 1400 témoins). L’ADN a été extrait à partir des échantillons biologiques, les variants génétiques des gènes candidats ont été sélectionnés, et le génotypage a été réalisé en même temps sur l’ensemble des 2100 échantillons d’ADN.
Nous réalisons actuellement les analyses statistiques permettant d’étudier
(i) les relations entre le phénotype pigmentaire, l’exposition aux rayonnements ultraviolets et le risque de mélanome ;
(ii) les associations entre l’exposition solaire, le nombre de naevi, et le risque de mélanome cutané selon le site anatomique et le type histologique de la tumeur (permettant de tester l’hypothèse de l’hétérogénéité du mélanome (hypothèse des « mécanismes divergents »)) ;
(iii) les relations entre les polymorphismes de certains gènes et la pigmentation et la propension à développer des naevi ;
et (iv) les associations entre ces polymorphismes et le risque de mélanome.
Les résultats issus de ce projet de recherche permettront d’améliorer les connaissances disponibles en ce qui concerne les relations entre le risque de mélanome et certains facteurs génétiques, et leur interaction avec le phénotype pigmentaire et l’exposition aux rayonnements ultraviolets. Ils permettront de tester et d’affiner l’hypothèse des « mécanismes divergents » pour l’étiologie du mélanome par l’intégration de données génétiques dans le modèle, en testant notamment l’effet des gènes liés aux naevi, ceux liés à la pigmentation ainsi que ceux associés au mélanome dans les récentes études génétiques portant sur l’intégralité du génome.
A terme, les résultats provenant de ce projet contribueront à identifier les polymorphismes génétiques conférant un risque accru de mélanome ainsi que leur interaction avec l’exposition solaire, et pourraient mener à de nouvelles stratégies de prévention et de traitement de ce cancer.