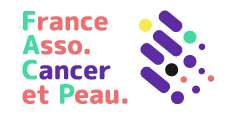Novembre 2014 – La prise en charge du mélanome malin dit avancé, c’est-à-dire compliqué de métastases a récemment connu des progrès considérables avec la mise au point de nouvelles molécules destinées soit à inhiber des mutations (nommées BRAF ou MEK) présentes au niveau des cellules de mélanome dont elles favorisent la prolifération, soit à stimuler le système immunitaire pour aider à l’élimination des cellules tumorales (immunothérapie). Les résultats des premiers essais se sont avérés très encourageants et ceux de nouvelles études de phase III ont été largement présentés et commentés au dernier congrès de l’European Society for Medical Oncology (ESMO) qui s’est tenu du 26 au 30 septembre à Madrid.
Deux inhibiteurs valent mieux qu’un
L’efficacité d’un traitement par un inhibiteur de BRAF dans les mélanomes avancés présentant une mutation du gène BRAF est désormais bien établie. Malheureusement, il apparaît que certaines tumeurs peuvent développer une résistance vis-à-vis des inhibiteurs de BRAF, laquelle peut être combattue par l’ajout d’un traitement par un inhibiteur de MEK. Ainsi dans une étude, les 254 patients qui ont reçu un inhibiteur de BRAF (vémurafenib) plus un inhibiteur de MEK (cobimétinib) ont-ils bénéficié d’une durée médiane d’évolution sans progression de la maladie (survie sans progression) plus longue que les 239 qui n’ont été traités que par le vémurafenib seul (9,9 mois contre 6,2 mois) avec une diminution de 35 % du risque de décès. Il y a eu 68 % de réponses partielles et complètes avec le traitement combiné et 45 % avec le vémurafenib seul. Les effets secondaires importants ont été plus fréquents sous traitement combiné mais n’ont pas davantage donné lieu à une interruption de traitement que dans le groupe vémurafenib seul. De plus l’association du cobimétinib a considérablement réduit le taux de survenue de cancers cutanés non mélaniques (cancers épidermoïdes) et d’autres tumeurs cutanées (kératoacanthomes), effet secondaire particulier des inhibiteurs de BRAF.
Un second essai de même type, présenté par le Dr Caroline Robert de l’IGR, illustre également l’intérêt de l’association de deux inhibiteurs. Il a été mené chez 704 patients atteints d’un mélanome avancé avec une mutation BRAF et a comparé l’efficacité d’une association de dabrafénib (autre inhibiteur de BRAF) avec le tramétinib (inhibiteur de MEK), administrée à 352 malades à celle du vémurafenib seul (352 malades). La durée médiane de survie sans progression est dans le premier cas de 11,4 mois et de 7,3 mois dans le second avec un taux de bonnes réponses de 64 % et 51 % respectivement, une réduction de la fréquence des tumeurs cutanées sous le traitement combiné et un niveau de tolérance comparable pour les deux types de traitement.
Un autre type d’immunothérapie
Schématiquement, l’immunothérapie dans le mélanome malin a pour but de restaurer la fonction immunitaire des lymphocytes T. L’ipilimumab, un anticorps monoclonal qui agit contre une protéine exprimée à la surface de ces cellules (CTLA-4) empêchant leur prolifération et leur action antitumorale a été l’un des premiers à être testé avec succès chez les patients atteints de mélanome avancé. Mais il semble que son effet puisse s’amoindrir avec le temps et d’autres voies sont explorées.
Des anticorps monoclonaux humanisés dirigés contre un récepteur exprimé par les cellules T stimulées par un antigène et inhibant alors leur prolifération et leur cytotoxicité, le PD-1 (programmed death 1 receptor) ont été développés parmi lesquels le nivolumab. Administré à des patients dont le mélanome continuait de progresser sous ipilimumab et inhibiteur de BRAF, il prolonge significativement leur survie sans progression et leur survie globale par rapport à des malades qui ne reçoivent qu’une chimiothérapie classique, et avec moins d’effets secondaires.
La stratégie virale
Depuis des décennies, on sait que certains virus sont capables de détruire les cellules cancéreuses. Avec les progrès technologiques et biologiques, il est désormais possible d’envisager un traitement « oncolytique » des tumeurs avec des virus conçus pour infecter spécifiquement les cellules tumorales mais non toxiques pour les cellules saines. Au congrès de l’ESMO, l’efficacité potentielle d’un virus proche de celui de l’herpès (Talimogene laherparepvec ou T-VEC) élaboré pour se répliquer dans la tumeur (et la détruire) et augmenter la réponse immunitaire en produisant du GM CSF (granulocyte macrophage colony stimulating factor) a été beaucoup commentée. Le traitement est destiné aux patients souffrant d’un mélanome non opérable avec des métastases régionales et à distance. Il est injecté dans les lésions elles-mêmes. Le taux de réponse obtenu est supérieur à celui observé après GM-CSF seul, la durée de survie est augmentée et la tolérance satisfaisante.
Dr Marie-Line Barbet
Communications à l’European Society for Medical Oncology