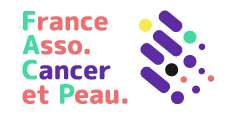Le mélanome fut la « vedette » cette année à l’ASCO avec deux essais de phase III en séance plénière, tous deux rapportant une augmentation de survie globale chez des patients atteints de mélanome métastatique!
Ces deux essais sont publiés dans le New England Journal of Medicine.
Source de ces articles: http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1104621 et http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1103782
Rappelons que les patients souffrant de mélanome de stade 3 non opérables ou 4 ont une survie moyenne de moins d’un an et que les traitements aujourd’hui sur le marché n’ont jamais été capables de démontrer un effet sur la durée de vie.
L’immunothérapie par ipilimumab (présentation J Wolchok)
L’an dernier, l’immunothérapie par ipilimumab (3 mg/kg) a démontré une efficacité significative sur la survie moyenne de ces patients après une première ligne de traitement par rapport à une vaccination anti-tumorale (peptides gp100).
Cette année, nous avons les résultats d’une deuxième étude de phase III menée chez 500 patients et comparant dans le cadre d’une randomisation 1/1 le traitement par chimiothérapie standard, la dacarbazine, à l’association dacarbazine + ipilimumab (10 mg/kg).
Cette étude confirme le bénéfice de l’ipiliumab + dacarbazine en terme de survie globale avec une diminution du risque de décès de 28% (P = 0.0009). Les durées de réponse sont significativement augmentées par l’ipilimumab : 19.3 mois, versus 8.1 mois avec la chimiothérapie seule. Le pourcentage de patients vivants après 1, 2 et 3 ans est augmenté de 10% environ avec l’association par rapport à dacarbazine seule.
Des effets secondaires de grade 3 et 4 en lien avec le traitement ont été observés plus fréquemment avec l’association (50 vs 27.5%). Il s’agissait la plupart du temps d’effets d’ordre immunologique mais le spectre de toxicité était un peu différent de celui auquel on est habitué avec l’ipilimumab car il y eut 32% d’hépatite de grade3/4 vs 2.4% avec la dacarbazine. Il n’y a pas eu de décès lié au traitement dans le bras ipilimumab + dacarbazine et un décès dans le bras chimiothérapie seule (hémorragie digestive).
La thérapie ciblée par vemurafenib (présentation P Chapman)
Un deuxième essai de phase III a évalué le vemurafenib, inhibiteur de BRAF versus la dacarbazine chez des patients atteints de mélanome porteurs de la mutation de BRAF V600E. On sait que cette protéine est mutée dans environ 50% des cas de mélanomes. On connaissait les résultats extrêmement prometteurs des phases I et II qui avaient montré des réponses spectaculaires et rapides chez plus de 50% des patients. Cet essai a confirmé le taux important de réponses objectives (48.4% avec le vemurafenib vs 5.5% avec la dacarbazine) et un fort effet sur la survie sans progression (5.3 vs 1.6 mois). La survie globale est aussi significativement augmentée avec une diminution du risque de décès de 67% (hazard ratio de 0.33 et p<0.0001). Le recul n’est pas suffisant pour connaitre les moyennes de survie globale dans chacun des deux groupes. Un an après le début de l’essai, au regard des résultats très positifs de l’essai, un amendement fut déposé, autorisant un cross-over du bras dacarbazine vers vemurafenib pour les patients en progression.
Les effets secondaires les plus préoccupants sont cutanés : importante photosensibilité et émergence de prolifération kératinocytaires de type kératoacanthomes et carcinomes épidermoïdes cutanés chez environ 20% des patients.
Traitement adjuvant (présentation A Eggermont)
Les résultats de l’essai EORTC évaluant l’interféron pégylé (Peg Intron) vs observation chez les patients de stade III, avec une atteinte ganglionnaire micoscopique (ganglion sentinelle positif, N0) ou maroscopique (N1) après lymphadénectomie, sont aujourd’hui évalués avec un recul de 7.6 années.
Ils confirment un effet favorable de l’interféron sur la survie sans progression sans effet sur la survie globale.
L’étude avait été prévue de façon à pouvoir analyser prospectivement différents sous groupes, et notamment les mélanomes ulcérés et les patients N0 vs N1. Les résultats plus matures dont nous disposons aujourd’hui renforcent l’hypothèse déjà formulée lors de l’analyse initiale des résultats selon laquelle l’effet bénéfique de l’interféron s’exerce principalement sur la sous-population de patients ayant un mélanome ulcéré et une atteinte ganglionnaire microscopique (N1 ulcérés). Chez ces patients, la survie sans récidive est très favorisée par l’interféron (p : 0.006, HR : 0.72) avec même un effet sur la survie ( p : 0.006, HR : 0.59)
Un essai sera prochainement réalisé sur des patients ayant un mélanome primitif ulcéré afin de tester de façon prospective et contrôlée l’hypothèse d’un effet bénéfique de l’interféron sur cette sous-population de mélanomes.
Les bémols
Nous avons franchi de grandes étapes avec ces essais de phase III positifs. Les deux médicaments, l’ipilimumab et le vemurafenib sont déjà disponibles en ATU en France auront prochainement leur AMM (L’ipilimumab a déjà une AMM aux US, son nom commercial est Yervoy®.
Cependant, l’ipilimumab, même s’il donne des réponses durables et a un indiscutable effet sur la survie des patients, n’est efficace que chez une faible proportion de patients, moins de 20% d’entre eux. On ne connait pas aujourd’hui de paramètres prédictifs ou précoces qui nous permettraient d’identifier et de sélectionner les patients potentiellement répondeurs à cette immunothérapie.
Par ailleurs, le vemurafenib ne peut être donné que chez 50% des patients, car il est inefficace voire délétère chez les patients dont le mélanome n’est pas muté sur BRAF.
De plus, même si le vemurafenib prolonge significativement la durée de vie des patients, on sait aujourd’hui qu les re-progression après 6 à 8 mois de traitement sont très fréquentes.
On a commencé à caractériser les mécanismes de ces résistances secondaires, et cela a fait l’objet de plusieurs posters et communications. Il s’agit dans la plupart des cas de réactivations de la voie des MAPK kinases via des activations (mutationnelles ou non) d’autres gènes intervenant sur cette voie : NRAS, MEK ou par activation d’autres voies de signalisation (voie PI3Kinases).
Les nouveaux défis, les perspectives
Nous allons donc devoir au cours des années qui viennent trouver d’autres cibles pour atteindre aussi les mélanomes non mutés en V600E/KBRAF, élucider et prévenir le résistances secondaires aux anti-BRAF, identifier des biomarqueurs prédicitifs de l’efficacité de l’ipilimumab.
D’autres médicaments aussi très prometteurs sont en phase plus précoce de développement. Les anti-MEK (MEK est situé en aval de BRAF sur la voie des MAP-kinases) sont développés par plusieurs laboratoires. Ils donnent des résultats très impressionnants au cours d’une phase I d’association avec l’anti BRAF (les deux inhibiteurs présentés dans cet essai d’association sont développés par GSK). Cette association pourrait également prévenir les carcinomes cutanés induits par les anti-BRAF.
De nouvelles immunothérapies agissant sur PD1 ou son ligand ont le même objectif que l’ipilimumab et donnent de bons signaux d’efficacité au cours de leur développement précoce. Ils seraient de plus moins toxiques que l’ipilimumab.
Se met en place aujourd’hui un partenariat entre les deux laboratoires qui développent respectivement l’ipilimumab et le vemurafenib, BMS et Roche afin de tester l’association de ces deux médicaments, qui semble effectivement extrêmement logique à envisager chez les patients ayant une mutation de BRAF.
En conclusion :
1. Deux phases III positives avec deux AMM prochaines plus que probables, ipilimumab et vemurafenib
2. Des hypothèses à vérifier pour les facteurs prédictifs d’efficacité de l’interféron alpha en adjuvant
3. D’autres médicaments et association très prometteurs : anti MEK, anti-PD1.
4. Un essai de combinaison ipilimumab + vemurafenib se met en place sur la base d’un partenariat entre BMS et Roche.
Caroline ROBERT
Chef de Service de Dermatologie
Institut Gustave Roussy